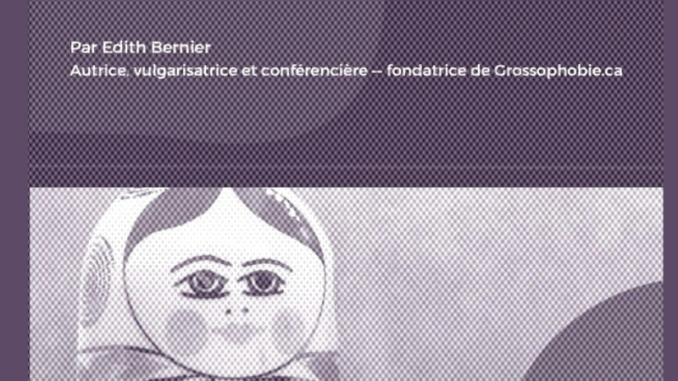
| Date de parution | Janvier 2023 (avec mise à jour en 2025) |
| Client·e | Arrimage Organisme qui fait la promotion de l’acceptation du corps et la diversité corporelle |
| Description | Guide qui explique ce qu’est la grossophobie, ses origines, ses conséquences et propose des pistes d’action pour la combattre et promouvoir l’acceptation de la diversité corporelle. |
| Lien | Pour consulter l’ensemble du guide sur le site d’Arrimage |
Qu’est-ce que la grossophobie?
Note : Dans ce document, les termes « régime » et « diète » sont utilisés de façon interchangeable et sont définis comme la privation ou la modification alimentaire dans le but de perdre du poids, à moins d’indication contraire.
En théorie, la grossophobie est définie dans le dictionnaire Le Robert comme une « attitude de discrimination envers les personnes obèses ou en surpoids ». Concrètement, il s’agit d’une vaste et complexe gamme de comportements, de réactions, d’émotions, de jugements, de prédispositions, etc. La grossophobie peut s’exprimer de nombreuses façons, du geste complètement délibéré à des réactions ou des choix plus subtils, parfois même inconscients.
Selon une étude américaine de 2012, au lieu d’être obèse, les personnes interrogées choisiraient plutôt…
● de divorcer (30 %)
● de ne pas pouvoir avoir d’enfants (25 %)
● de mourir 10 ans plus tôt (15 %)
● de vivre une dépression sévère (15 %)
● d’être alcoolique (14 %)
● d’être amputé d’un membre (5 %)
● d’être aveugle (4 %)
De plus, 10 % des personnes interrogées préféreraient que leur enfant soit anorexique plutôt qu’obèse. (1)
Exemples de gestes, de choix ou de réactions grossophobes :
● Insulter, bousculer, intimider ou ridiculiser une personne à cause de son poids
● Commenter négativement le poids ou les habitudes (alimentaires, sportives, etc.) d’une
personne grosse
● Tenir pour acquis que toutes les personnes grosses aspirent à maigrir — que ce soit par la diète ou par l’exercice — ou leur donner des conseils non sollicités en ce sens
● Porter uniquement des vêtements qui « avantagent » ou font paraître plus mince ou juger les personnes qui portent des vêtements jugés « peu flatteurs »
● Avoir honte ou refuser d’être vu avec des personnes grosses ou des les fréquenter (amoureusement, socialement, etc.)
Qu’est-ce qui fait qu’une personne est grosse?
C’est une question épineuse. À ce jour, il n’y a d’ailleurs pas de réponse claire ou de consensus à ce sujet. Beaucoup s’entendent cependant sur le fait que c’est généralement le niveau de contraintes expérimentées par quelqu’un qui pourrait définir où cette personne se situe sur le spectre de la grosseur.
Ces contraintes sont diverses et nombreuses : difficulté à trouver des vêtements à sa taille, défis à trouver des sièges assez grands ou assez solides pour supporter son poids, rejet de la part des autres (amitié, relation amoureuse ou intime, etc.) ou des organisations (milieux académiques, milieux professionnels, etc.).
Plus on vit de contraintes réelles liées directement à son poids ou sa taille, plus on tend à s’approcher de la partie du spectre définissant une personne comme étant grosse.
Aussi étonnant que cela puisse paraître, selon l’endroit dans lequel on évolue dans le monde, on peut « devenir » grosse ou gros plus rapidement… Il faut savoir que dans certaines régions du monde, les infrastructures, les vêtements, les normes sociales et autres composantes sont encore plus restrictifs en matière de taille qu’en Amérique du Nord.
Ça vient d’où?
La grossophobie découle entre autres de la cristallisation de plusieurs tendances de la société à dénigrer les corps gros et ce qui leur est associé, et ce, souvent à tort.
Parmi ces tendances, on en retrouve deux au premier plan : la culture de la diète et le culte de la minceur. Ces deux tendances s’entremêlent régulièrement l’une dans l’autre; d’ailleurs, certains spécialistes de la question les regroupent souvent à l’intérieur d’un seul et même concept, mais qui cause autant de dommages.
[…]
La grossophobie dans la culture populaire
Depuis très longtemps, on associe la beauté, le succès et l’attirance aux corps minces alors que les corps gros représentent tout ce qu’il y a de plus indésirable en société.
D’après l’historien français Georges Vigarello, les personnes grosses seraient associées à des aspects négatifs depuis… le Moyen-Âge! Mais c’est approximativement à partir de la fin des années 1950 que la grossophobie telle qu’on la connaît aujourd’hui se développe.
Que ce soit au cinéma ou à la télé, dans la mode ou encore dans la publicité, les corps gros sont traditionnellement absents.
[…]
On est tous grossophobes!
C’est le cruel constat auquel la majeure partie de la population arriverait s’il existait une méthode afin de mesurer la grossophobie au sein de la société. Bien qu’elle soit exprimée de différentes façons et selon des ampleurs qui fluctuent, la grossophobie et ses préjugés se retrouvent bien ancrés dans chacune et chacun de nous.
Nous y avons été exposés depuis notre plus tendre enfance, que ce soit par le divertissement destiné aux tout-petits ou l’éducation reçue, la forte majorité des parents et grands-parents actuels ayant eux-mêmes été élevés selon des principes grossophobes.
Ce rappel n’a pas pour objectif de blâmer qui que ce soit; il s’agit en fait d’un rappel que nous avons évolué dans un contexte qui incite à perpétuer les clichés négatifs à l’égard des personnes plus grosses en plus de célébrer la minceur, associant cette dernière au succès, à la beauté et à la santé. Et que le contexte dans lequel on a grandi, tout comme le contexte dans lequel on vit présentement, persiste à dévaloriser les personnes grosses.
[…]
Savoir (se) pardonner
La prise de conscience individuelle et collective à l’égard de la grossophobie et des dommages qu’elle peut causer est très récente. Comme indiqué précédemment, nous sommes en très forte majorité issus d’une éducation grossophobe et d’une exposition constante à des préjugés négatifs à l’égard de la grosseur.
S’il est important de faire un autoexamen et d’admettre que nous avons posé des gestes relevant de la grossophobie par le passé, il faut aussi savoir se pardonner.
Il peut être une bonne idée de faire amende honorable auprès des personnes affectées également, dans la mesure où l’on sait qu’on ne risque pas de causer plus de tort que de bien. Dans certains cas, par contre, il faudra apprendre à vivre avec les erreurs du passé et surtout, s’assurer de ne pas les répéter.
(1) Schwartz, M. B., Vartanian, L. R., Nosek, B. A. et Brownell, K. D. (2006), The Influence of One’s Own Body Weight on Implicit and Explicit Anti-fat Bias. Obesity, 14 : 440-447. https://doi.org/10.1038/oby.2006.58